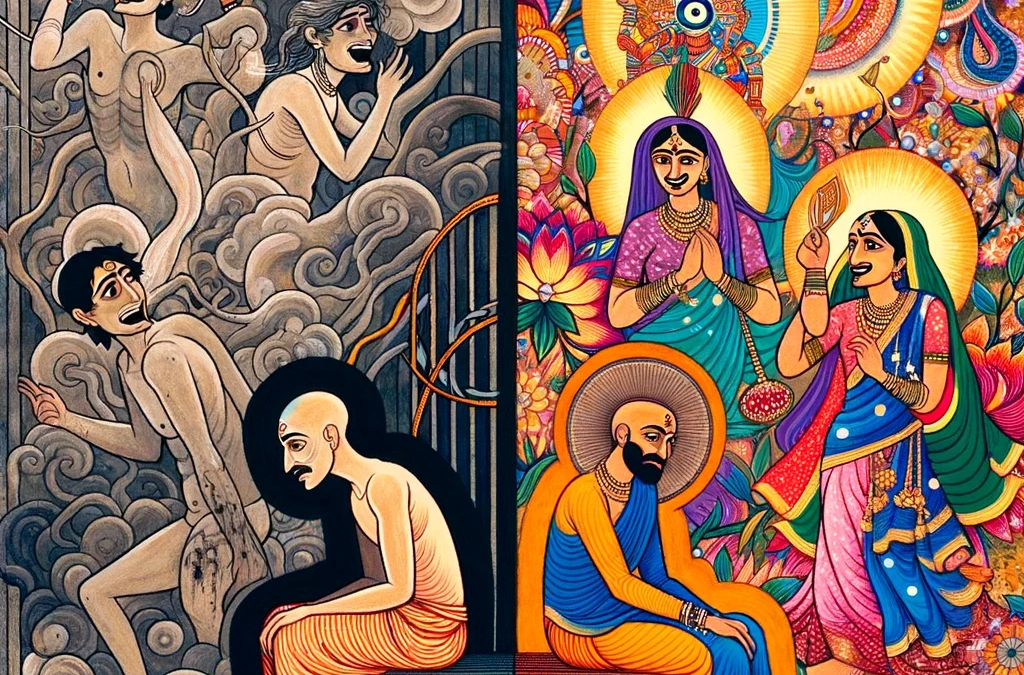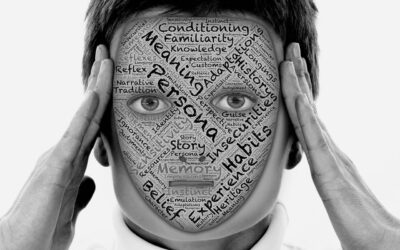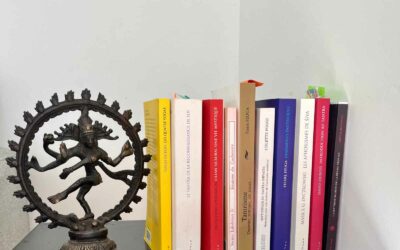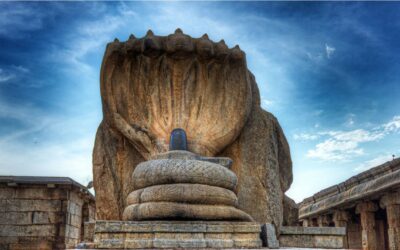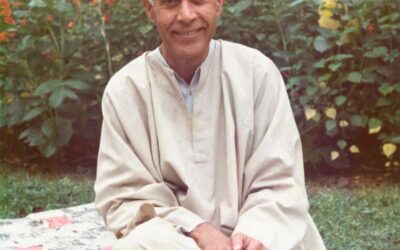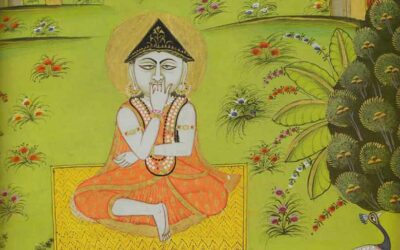Introduction Le sujet de cette article est de répondre à la question : " En tant qu'être humain la souffrance m'est insupportable, si Dieu existe pourquoi les guerres, pourquoi la souffrance est telle dans le monde?". J'ai extrait puis traduit certaines citations...